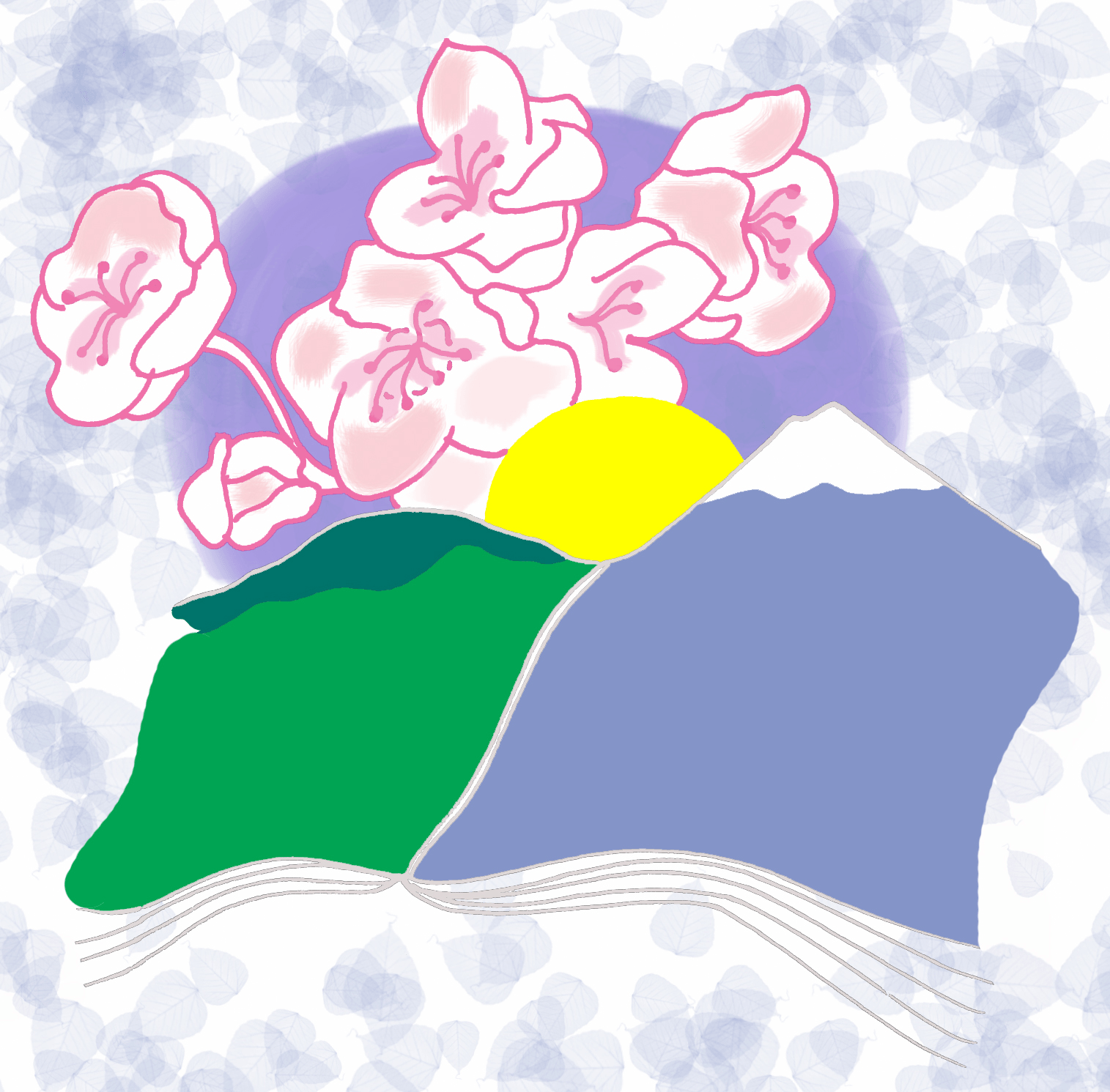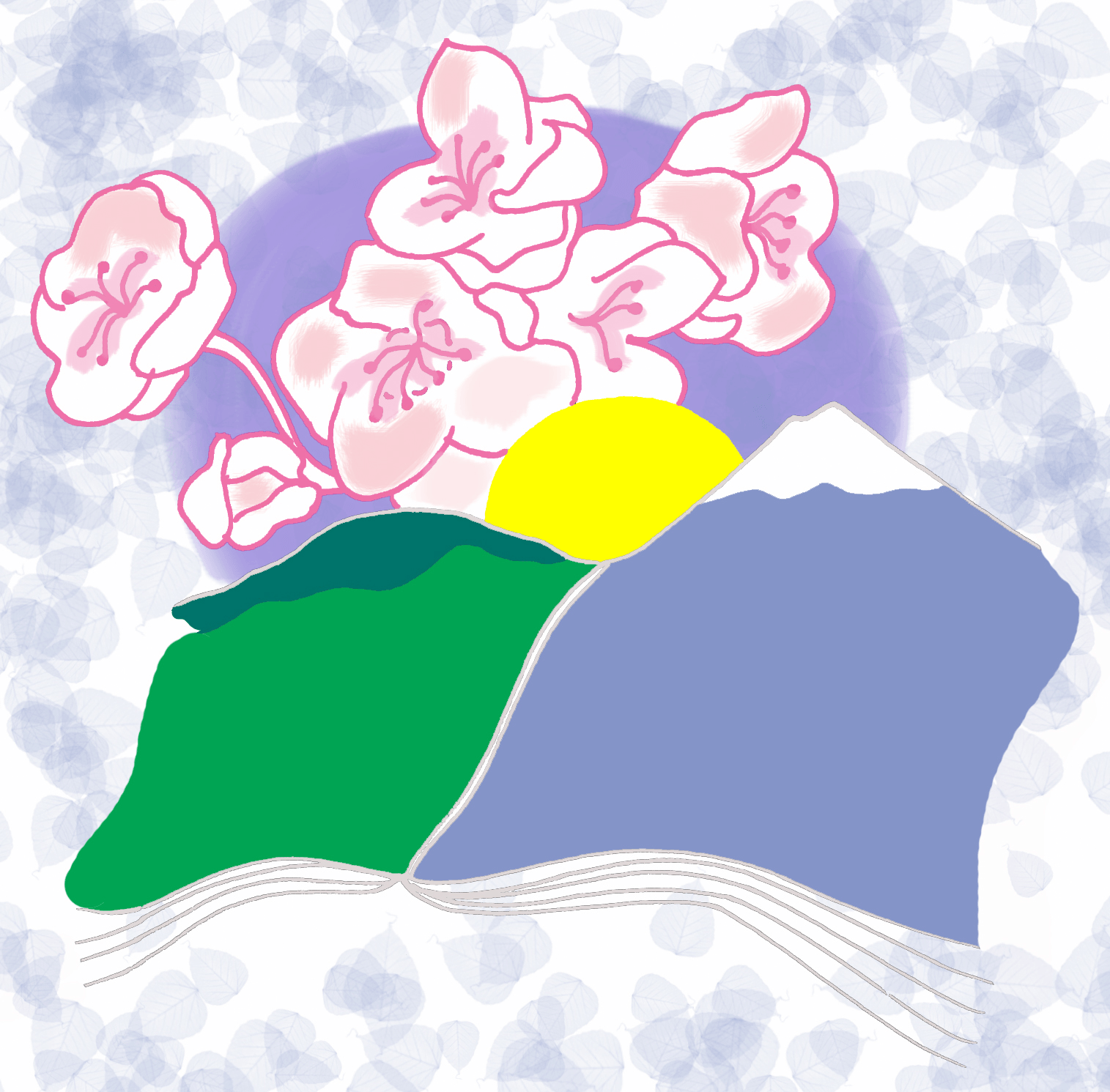Par Tomoko Mihara
Maître de conférence à l’Université de Gunma
Japon
Cet article nous a semblé intéressant car il montre comment la traduction de la littérature française est le miroir de la société japonaise.
Au Japon, la publication des œuvres occidentales commença seulement dans les années 1870. Certes, auparavant, déjà sous le régime féodal, quelques textes hollandais avaient été importés, traduits et avaient circulés sous le manteau dans les milieux intellectuels. Mais on n’avait pas pu en publier les traductions sous peine de mort. En effet, avant 1854, le pays avait été complètement fermé aux Européens ; l’importation des objets étrangers (notamment les livres) étaient strictement interdite. Autrement dit, même après le changement de régime (en 1868), et même après l’installation du nouveau système d’enseignement (en 1872), le nombre des Japonais versés dans la langue française fut vraiment minime ; il s’agissait des élites universitaires, des étudiants et des professeurs, ardents à occidentaliser un Japon archaïque, à éclairer le peuple sur les idées avancées. Compte tenu de ce contexte, il n’est pas très étonnant que les romans de Jules Verne (dont Le Tour du monde en quatre-vingts jours, traduit et publié en 1878) aient été parmi les premiers textes traduits en japonais ; les ouvrages correspondaient exactement au goût de ces intellectuels aspirant au monde nouveau, au progrès scientifique et industriel. On publia également assez tôt les romans de Alexandra Dumas (père) et ceux de Victor Hugo. Leurs textes traitant de la Révolution subirent un remaniement libre de la part des traducteurs, et furent transformés en livres de propagande, pour susciter l’enthousiasme chez les militants des mouvements libéraux (par exemple, les Mémoires d’un médecin de Dumas traduit en 1882, et les Quatre-vingt-treize de Hugo en 1884).
Pour les œuvres de Flaubert, la publication commença autour de 1920, avec un peu de retard par rapport à d’autres romans français. Mais il est probable que ses romans furent connus par les universitaires plus tôt que cette date, comme la première version japonaise de Salammbô, texte difficile à traduire, paru déjà en 1914. Notons que la traduction de Madame Bovary fut publiée en 1920, et celle de la La Tentation de Saint Antoine en 1924. En 1935, dix ans après ces publications partielles de l’œuvre flaubertienne, un éditeur, Kaïzosha, publia pour la première fois les Œuvres complètes de Flaubert composées de 9 volumes, dont Madame Bovary, L’Éducation sentimentale, Salammbô, La La Tentation de saint Antoine, Bouvard et Pécuchet, Trois Contes, Œuvres de jeunesse, Récit de voyage [sic], la Correspondance et les Souvenirs intimes de Caroline Commanville. Tous les ouvrages majeurs de l’écrivain ont paru à ce moment-là (en comparaison, les traductions des Œuvres complètes Stéphane Mallarmé sont toujours en train de paraître). Néanmoins, il ne s’agit que d’un commencement. Pour la publication massive des textes de Flaubert, on dut attendre la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Depuis 1945, de fait, c’est le rush des retraductions. Les chiffres montrent l’envergure de la marée : pendant les années 40, on compte 22 (re)publications des traductions de Flaubert, alors qu’avant guerre, pendant plus de 50 ans, onze seulement avaient paru. Au total, le Japon connaît depuis l910 jusqu’à aujourd’hui environ 120 textes traduits de Flaubert, publiés par différents éditeurs dans différents formats.
Il est évident que l’engouement des Japonais pour notre écrivain ne peut pas expliquer à lui seul ce nombre phénoménal de publications. En fait, il existe d’autres raisons plus terre à terre que le pur désir de la lecture. En premier lieu, il s’agit d’une raison pécuniaire. Dans le Japon d’autrefois, le droit de traduction n’était pas strictement défini, si bien que les traducteurs vendaient leurs textes à différents éditeurs, après avoir changé quelques expressions le cas échéant, pour tirer le profit maximum de leurs travaux. Et les éditeurs, de leur côté, réutilisèrent les vieux textes publiés par d’autres petits éditeurs, en s’arrangeant pour ne pas violer le copyright. Il en résulte que depuis 1920, Madame Bovary a connu 56 versions japonaises, alors que les traducteurs ne sont que 12 au total. On a beau acheter des éditions différentes d’éditeurs différents, on peut très bien tomber sur les mêmes textes des mêmes traducteurs. Mais peut-être, pour les traducteurs, dont certains étaient des chercheurs éminents en lettres françaises et consacraient littéralement leur vie à répandre les cultures européennes, il ne s’agissait pas que de simples soucis d’argent. Ils purent en effet diffuser les romans de Flaubert plus largement, en faisant publier leurs traductions par divers éditeurs. Nous citons, parmi ces flaubertiens pionniers, surtout Takéhiko IBUKI, Rhôïchi IKUSHIMA, Kuro YAMADA et Jaku YAMADA.
Une autre raison de cette fièvre de publications doit se trouver dans la vogue des » recueils universels » des années 60 et 70. À l’époque, le Japon connut une croissance économique accélérée. Le PNB augmentait. Le niveau de vie s’élevait. Naturellement, on voulait aller plus vite, pour égaler les autres pays développés. Les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 ont encouragé ce climat d’exaltation. Néanmoins, pour rejoindre et dépasser les puissances mondiales, il est indispensable de les prendre d’abord pour exemple, d’apprendre leurs techniques et leurs cultures, donc leurs littératures. Soutenu par cette idéologie du temps, tous les éditeurs d’alors entamèrent la publication des Œuvres complètes des littératures du monde (Sékaï Bungaku Zénshû), en gros volumes cartonnés et nombreux, où figure la gamme entière des chefs-d’œuvre mondiaux, grec, français, allemands, russes, anglais et américains de toutes les époques. Le concept est simple : si on se procure cet ensemble, on a toutes les cultures occidentales à sa portée (en réalité, dans la plupart des cas, ces collections ornaient les rayons des bibliothèques publiques). Or, les textes de Flaubert s’adaptaient bien à ce nouveau style de publication. Surtout, Madame Bovary (et éventuellement Trois Contes) était immanquablement repris dans les » recueils universels » de différentes éditions. Le roman est non seulement une merveille aimée par le public, mais aussi il est un ouvrage maniable, pas trop long ni trop politisé.
En troisième lieu, la fréquence des retraductions s’explique par la nature même de la langue japonaise. En effet, depuis 100 ans, cette langue n’a pas cessé de changer, sous l’influence des cultures étrangères. Déjà à l’ouverture du pays aux étrangers, on fut obligé de fabriquer de nouveaux mots pour représenter les concepts inconnus à la culture japonaise. De plus, à mesure que la société était industrialisée et que la circulation devenait libre, la langue se rendait elle-même fluide. Elle changeait constamment les tournures, les vocabulaires et même les écritures. Autrement dit, au Japon, la langue d’une époque vieillit vite. Afin d’actualiser un ouvrage traduit, il est donc nécessaire de renouveler fréquemment la traduction, sinon le public se sent gêné avec les textes illisibles.